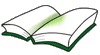Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Détail de la série
Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE |
Documents disponibles dans cette série (67)

 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la rechercheMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Adaptation et amelioration du logiciel d’aide a la prise de decision dans la gestion durable des retenues d’eau / Hamado OUEDRAOGO

Titre de série : Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE Titre : Adaptation et amelioration du logiciel d’aide a la prise de decision dans la gestion durable des retenues d’eau : GESTRET Type de document : texte imprimé Auteurs : Hamado OUEDRAOGO Année de publication : 2010 Importance : 55p. Langues : Français (fre) Résumé : Dans l’objectif d’apporter un outil en mesure d’accompagner les gestionnaires des ressources en eau dans la gestion des ces dernières le logiciel GESTRET a été développé au sein du 2iE entre 1998 et 2000. GESTRET un est logiciel qui d’une part offre une base de données sur les retenues d’eau et d’autre part permet de situer sur la disponibilité de la ressource.
Cependant, vu les difficultés rencontrées dans l’utilisation de ce dernier, le présent travail dont l’objectif principal est de fournir un outil d’aide à la gestion des retenues, a eu pour objectifs spécifiques d’apporter des réponses aux différentes insuffisances.
Il s’est effectué en plusieurs phases dont la première consiste en l’examen des éléments ayant conduit à la réalisation de cet outil. Ce sont essentiellement les données nécessaires à la gestion des retenues et l’utilisation qui est en faite dans le programme.
La seconde phase a conduit à l’examen de la structure de la base de données et des différentes procédures du programme. Cette étape a permis d’identifier les différents problèmes. Enfin la dernière phase a conduit au transfert de la base de données vers Microsoft Access et l’écriture de certaines procédures.
Ce travail a permis d’obtenir un logiciel permettant de mettre à jour les informations sur les retenues notamment grâce aux nouvelles fonctionnalités d’importation et d’exportation de données, et d’effectuer des simulations et des bilans. Il a également permis d’identifier des fonctionnalités qui pourraient être ajoutées telles que l’intégration des informations à référence à spatiale dans la base données, un module d’optimisation de l’utilisation de l’eau et la prise en compte des aspects sur la pollution. Ces fonctionnalités si toute fois elles sont ajoutées, rendront cet outil plus complet.
Abstract : In the objective to bring a measuring instrument to accompany the water resources managers, the software GESTRET was developed by the 2iE between 1998 and 2000. GESTRET is a software which on one hand offers a database on water reserves and on the other hand makes it possible to konow about the availability of the resource.
However, considering the difficulties encountered in the use of this software, the present work whose main aim is to provide a tool of assistance to the management of reserves, had as specific objectives to bring answers to the various insufficiencies.
It was carried out in several phases of which the first consisting with the examination of the elements having permitted the realization of this software. They are primarily the data necessary to the management of reserves and their use that are made in the program.
The second phase led to the examination of the structure of the database and the various procedures of the program. This stage made it possible to identify the various problems. Finally the last phase led to the transfer of the database towards Microsoft Access and the writing of certain procedures.
This work has made it possible to obtain a software allowing the update of information on reserves and to carry out simulations and assessments. It also made it possible to identify some functionalities which could be added such as the integration of information with spacial reference into the database given, a module of optimization of the use of water and the taking into account of the aspects on pollution. These functionalities if added, they will make this software more complete.Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Adaptation et amelioration du logiciel d’aide a la prise de decision dans la gestion durable des retenues d’eau : GESTRET [texte imprimé] / Hamado OUEDRAOGO . - 2010 . - 55p.
Langues : Français (fre)
Résumé : Dans l’objectif d’apporter un outil en mesure d’accompagner les gestionnaires des ressources en eau dans la gestion des ces dernières le logiciel GESTRET a été développé au sein du 2iE entre 1998 et 2000. GESTRET un est logiciel qui d’une part offre une base de données sur les retenues d’eau et d’autre part permet de situer sur la disponibilité de la ressource.
Cependant, vu les difficultés rencontrées dans l’utilisation de ce dernier, le présent travail dont l’objectif principal est de fournir un outil d’aide à la gestion des retenues, a eu pour objectifs spécifiques d’apporter des réponses aux différentes insuffisances.
Il s’est effectué en plusieurs phases dont la première consiste en l’examen des éléments ayant conduit à la réalisation de cet outil. Ce sont essentiellement les données nécessaires à la gestion des retenues et l’utilisation qui est en faite dans le programme.
La seconde phase a conduit à l’examen de la structure de la base de données et des différentes procédures du programme. Cette étape a permis d’identifier les différents problèmes. Enfin la dernière phase a conduit au transfert de la base de données vers Microsoft Access et l’écriture de certaines procédures.
Ce travail a permis d’obtenir un logiciel permettant de mettre à jour les informations sur les retenues notamment grâce aux nouvelles fonctionnalités d’importation et d’exportation de données, et d’effectuer des simulations et des bilans. Il a également permis d’identifier des fonctionnalités qui pourraient être ajoutées telles que l’intégration des informations à référence à spatiale dans la base données, un module d’optimisation de l’utilisation de l’eau et la prise en compte des aspects sur la pollution. Ces fonctionnalités si toute fois elles sont ajoutées, rendront cet outil plus complet.
Abstract : In the objective to bring a measuring instrument to accompany the water resources managers, the software GESTRET was developed by the 2iE between 1998 and 2000. GESTRET is a software which on one hand offers a database on water reserves and on the other hand makes it possible to konow about the availability of the resource.
However, considering the difficulties encountered in the use of this software, the present work whose main aim is to provide a tool of assistance to the management of reserves, had as specific objectives to bring answers to the various insufficiencies.
It was carried out in several phases of which the first consisting with the examination of the elements having permitted the realization of this software. They are primarily the data necessary to the management of reserves and their use that are made in the program.
The second phase led to the examination of the structure of the database and the various procedures of the program. This stage made it possible to identify the various problems. Finally the last phase led to the transfer of the database towards Microsoft Access and the writing of certain procedures.
This work has made it possible to obtain a software allowing the update of information on reserves and to carry out simulations and assessments. It also made it possible to identify some functionalities which could be added such as the integration of information with spacial reference into the database given, a module of optimization of the use of water and the taking into account of the aspects on pollution. These functionalities if added, they will make this software more complete.Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques

Mémoire_OUEDRAOGO, Hamado.Adobe Acrobat PDFMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Alimentation en eau potable en milieu rural : Prise en charge des points d’eau par les communautés villageoises (Burkina FASO) / Halimatou HALIDOU YACOUBA

Titre de série : Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE Titre : Alimentation en eau potable en milieu rural : Prise en charge des points d’eau par les communautés villageoises (Burkina FASO) Type de document : texte imprimé Auteurs : Halimatou HALIDOU YACOUBA Année de publication : 2008 Importance : 54p. Langues : Français (fre) Résumé : Le Burkina Faso, en tant que pays sahélien est confronté à un problème de disparités en ressources en eau.
L’approvisionnement en eau potable des villages repose sur des forages. D’importants moyens financiers et humains sont déployés pour leur réalisation
Cependant, malgré l’importance de ces ouvrages le constat général qui se dégage est que la plupart d’entre eux est mal gérée et certains sont même abandonnés.
Il est nécessaire de chercher les déficits de gestion et de proposer des solutions adéquates en vue d’assurer la pérennité de ces ouvrages.
La présente étude tente de décrire le fonctionnement du système de gestion communautaire, en faisant ressortir les acquis, les contraintes et les perspectives envisagées par l’Etat pour pallier de façon efficace et durable à ce déficit de gestionMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Alimentation en eau potable en milieu rural : Prise en charge des points d’eau par les communautés villageoises (Burkina FASO) [texte imprimé] / Halimatou HALIDOU YACOUBA . - 2008 . - 54p.
Langues : Français (fre)
Résumé : Le Burkina Faso, en tant que pays sahélien est confronté à un problème de disparités en ressources en eau.
L’approvisionnement en eau potable des villages repose sur des forages. D’importants moyens financiers et humains sont déployés pour leur réalisation
Cependant, malgré l’importance de ces ouvrages le constat général qui se dégage est que la plupart d’entre eux est mal gérée et certains sont même abandonnés.
Il est nécessaire de chercher les déficits de gestion et de proposer des solutions adéquates en vue d’assurer la pérennité de ces ouvrages.
La présente étude tente de décrire le fonctionnement du système de gestion communautaire, en faisant ressortir les acquis, les contraintes et les perspectives envisagées par l’Etat pour pallier de façon efficace et durable à ce déficit de gestionRéservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité HALIDOU YACOUBA Halimatou//0818 M. 0818 Monographie Bibliothèque CDI-Ouaga Documents Disponible Documents numériques

HALIDOUAdobe Acrobat PDFMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Analyse et cartographie de la situation institutionnelle actuelle de la gestion de l’eau agricole au Burkina Faso : cas de la province du Kadiogo / Louis NGUIMKENG DJAKWOURYH

Titre de série : Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE Titre : Analyse et cartographie de la situation institutionnelle actuelle de la gestion de l’eau agricole au Burkina Faso : cas de la province du Kadiogo Type de document : texte imprimé Auteurs : Louis NGUIMKENG DJAKWOURYH Année de publication : 2010 Importance : 63p. Langues : Français (fre) Résumé : L’étude de l’analyse et la cartographie de la situation institutionnelle actuelle de la gestion de l’eau agricole au Burkina Faso : cas de la province du Kadiogo ; a été conduite de juin à Septembre 2010. Son principal objectif était d’analyser et cartographier la situation institutionnelle actuelle de la gestion de l’eau agricole au Burkina Faso. Le questionnaire adressé aux informateurs clés et aux agents UAT et ZAT, constituait la méthode de collecte des données. Les résultats ont montré que, la gestion et la planification de l’eau agricole au Burkina est une réalité à 88,9% et 11,1% des enquêtés estiment que la gestion et planification ne sont pas effective et que cette GEA est assurée par MAHRH à travers la DGPV et la DADI au niveau central, et le comité de gestion ou comité d’usager au niveau local. La GEA, est pris en compte partiellement pendant les étapes : de design, construction, mobilisation de l’eau et la réhabilitation des ouvrages.31% des enquêtés avancent que la maintenance des AHA est réhabilitée par l’Etat le comité d’usagers à 42%, les projets à 19% et les collectivités à 8%. Selon les personnes enquêtées le S&E des AHA est assuré par la DADI /DGPV, les UAT et les ZAT. Il ressort que les données collectées par les UAT sont transférées sous formes de rapport au niveau de la ZAT ; à leur tour ils en font une synthèse qu’ils envoient au niveau de la direction provincial de l’agriculture chaque mois. Au niveau provincial une synthèse est faite et le rapport produit est envoyé au niveau régional. En fin le niveau régional transfert son rapport au niveau central. Il ressort des réponses de personnes enquêtées, sur la pratique de la notion de suivi évaluation des AHA qu’il est respectivement : faible (44%), moyenne (28%), forte (6%) et inexistant (22%). Il apparait enfin que, les agents insuffisants (67%), le manque de formation (56%), le manque de moyen financier (100%), le manque de moyen matériel (100%) et le manque de moyen logistique (78%) représentent les réponses des enquêtés sur les contraintes relatives à leur travail de terrain.
La gestion de l’eau agricole, représente un défi fondamental au développement. L’étude recommande que d’autres études soient menées au niveau de grands périmètres et dans plusieurs autres localités pour avoir une idée plus éclairées sur la gestion de l’eau agricole au Burkina Faso.
Abstract : The analysis and cartography of the actual institutional situation of agricultural water management in Burkinna Faso: kadiogo local government case study was carried out from June to September 2010. Its main objective was to analyze and map out the actuel institutional situation of agricultural water management in Burkina Faso. The questionnaire addressed to key informers and UAT and ZAT agents, makes the method of data collection. The results showed that, the management and planning of agricultural water in Burkina Faso is a reality at 88.89% and 11.11% of the surveyed thing that the management and planning is not existent and this management is provided by MAHRH through the DGPV and DADI at central level, and the management committee or user committee at local level. The AWM is partially considered within the stages of design, construction, mobilization of water and rehabilitation of construction site and maintenance of irrigation schemes is rehabilitated at 31% by the user committee, at 42% by the Government, projects at 19% and collectivities at 8%. According to the surveyed, the motoring and evaluation of irrigation schemes is provided by DADI/DGPV, the UAT and the ZAT. It is obvious that the data gathered by the UAT are transferred in the form of report to the ZAT, in turn make a synthesis and send at the provincial direction of agriculture each month. At the provincial level, a synthesis is done and the report is sent to regional level. Finally the regional level transfers its report at the central level. The result from the surveyed persons on the practice of monitoring and evaluation of irrigated schemes showed that it is respectively: low (44%), average (28%), high (6%) and inexistent (22%). It appears finally that the staff shortness (67%), the lack of training (56%), lack of financial means (100%) and the lack of logistics (78%) represent the answers of the surveyed persons on the constraints relative to their work on the field.
The agricultural water management represents the fundamental challenge to the development. This study recommends that others study should be carried out on larger irrigation schemes and other places for more understanding idea of on the agricultural water management in Burkina Faso.Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Analyse et cartographie de la situation institutionnelle actuelle de la gestion de l’eau agricole au Burkina Faso : cas de la province du Kadiogo [texte imprimé] / Louis NGUIMKENG DJAKWOURYH . - 2010 . - 63p.
Langues : Français (fre)
Résumé : L’étude de l’analyse et la cartographie de la situation institutionnelle actuelle de la gestion de l’eau agricole au Burkina Faso : cas de la province du Kadiogo ; a été conduite de juin à Septembre 2010. Son principal objectif était d’analyser et cartographier la situation institutionnelle actuelle de la gestion de l’eau agricole au Burkina Faso. Le questionnaire adressé aux informateurs clés et aux agents UAT et ZAT, constituait la méthode de collecte des données. Les résultats ont montré que, la gestion et la planification de l’eau agricole au Burkina est une réalité à 88,9% et 11,1% des enquêtés estiment que la gestion et planification ne sont pas effective et que cette GEA est assurée par MAHRH à travers la DGPV et la DADI au niveau central, et le comité de gestion ou comité d’usager au niveau local. La GEA, est pris en compte partiellement pendant les étapes : de design, construction, mobilisation de l’eau et la réhabilitation des ouvrages.31% des enquêtés avancent que la maintenance des AHA est réhabilitée par l’Etat le comité d’usagers à 42%, les projets à 19% et les collectivités à 8%. Selon les personnes enquêtées le S&E des AHA est assuré par la DADI /DGPV, les UAT et les ZAT. Il ressort que les données collectées par les UAT sont transférées sous formes de rapport au niveau de la ZAT ; à leur tour ils en font une synthèse qu’ils envoient au niveau de la direction provincial de l’agriculture chaque mois. Au niveau provincial une synthèse est faite et le rapport produit est envoyé au niveau régional. En fin le niveau régional transfert son rapport au niveau central. Il ressort des réponses de personnes enquêtées, sur la pratique de la notion de suivi évaluation des AHA qu’il est respectivement : faible (44%), moyenne (28%), forte (6%) et inexistant (22%). Il apparait enfin que, les agents insuffisants (67%), le manque de formation (56%), le manque de moyen financier (100%), le manque de moyen matériel (100%) et le manque de moyen logistique (78%) représentent les réponses des enquêtés sur les contraintes relatives à leur travail de terrain.
La gestion de l’eau agricole, représente un défi fondamental au développement. L’étude recommande que d’autres études soient menées au niveau de grands périmètres et dans plusieurs autres localités pour avoir une idée plus éclairées sur la gestion de l’eau agricole au Burkina Faso.
Abstract : The analysis and cartography of the actual institutional situation of agricultural water management in Burkinna Faso: kadiogo local government case study was carried out from June to September 2010. Its main objective was to analyze and map out the actuel institutional situation of agricultural water management in Burkina Faso. The questionnaire addressed to key informers and UAT and ZAT agents, makes the method of data collection. The results showed that, the management and planning of agricultural water in Burkina Faso is a reality at 88.89% and 11.11% of the surveyed thing that the management and planning is not existent and this management is provided by MAHRH through the DGPV and DADI at central level, and the management committee or user committee at local level. The AWM is partially considered within the stages of design, construction, mobilization of water and rehabilitation of construction site and maintenance of irrigation schemes is rehabilitated at 31% by the user committee, at 42% by the Government, projects at 19% and collectivities at 8%. According to the surveyed, the motoring and evaluation of irrigation schemes is provided by DADI/DGPV, the UAT and the ZAT. It is obvious that the data gathered by the UAT are transferred in the form of report to the ZAT, in turn make a synthesis and send at the provincial direction of agriculture each month. At the provincial level, a synthesis is done and the report is sent to regional level. Finally the regional level transfers its report at the central level. The result from the surveyed persons on the practice of monitoring and evaluation of irrigated schemes showed that it is respectively: low (44%), average (28%), high (6%) and inexistent (22%). It appears finally that the staff shortness (67%), the lack of training (56%), lack of financial means (100%) and the lack of logistics (78%) represent the answers of the surveyed persons on the constraints relative to their work on the field.
The agricultural water management represents the fundamental challenge to the development. This study recommends that others study should be carried out on larger irrigation schemes and other places for more understanding idea of on the agricultural water management in Burkina Faso.Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques

Mémoire_ NGUIMKENG DJAKWOURYH, LouisAdobe Acrobat PDFMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Analyse de la dépendance entre les variables piézométriques et hydroclimatiques du Sud-Ouest du Burkina Faso / Romain FOKA

Titre de série : Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE Titre : Analyse de la dépendance entre les variables piézométriques et hydroclimatiques du Sud-Ouest du Burkina Faso Type de document : texte imprimé Auteurs : Romain FOKA Année de publication : 2010 Importance : 79p. Langues : Français (fre) Résumé : Cette étude a pour but d’évaluer la dépendance entre les niveaux piézométriques et les variables hydroclimatiques du sud-ouest du Burkina Faso. Dans ce pays, une bonne partie de la population dépend de l’eau souterraine pour son approvisionnement en eau potable. Le renouvellement de cette ressource est assuré par une recharge des aquifères qui dépend pour sa part des précipitations, de l’évapotranspiration et du ruissellement.. etc. Il est établi qu’une hausse de la température de l’air induit une plus forte évaporation et que l’infiltration des précipitations dépend du type d’événement pluvieux (durée, intensité, fréquence), ce qui pourrait amener une réduction de la recharge des aquifères.
Des séries chronologiques de niveaux piézométriques, des précipitations, des températures, de l’évapotranspiration potentielle, de l’humidité minimale et maximale, de la vitesse du vent et de débits de rivière ont été utilisées pour étudier la relation existant entre les climats et les niveaux d’eau dans les nappes aquifères. Les données disponibles pour cette étude rassemblent les informations provenant de 10 piézomètres, 14 stations de jaugeages et 6 stations météorologiques situées au Burkina Faso. Toutes les données s’étendent sur une longueur de 1 à 40. La statistique multivariée a été faite dans le but de voir le niveau de dépendance dans les jeux de données, ce niveau de dépendance a été ensuite confirmé par les tests statistiques de Student et de Mann Kendall. La modélisation sommaire du niveau de la nappe a été faite grâce à la régression linéaire multiple, enfin nous avons utilisé la régression linéaire en fonction du temps pour déterminer la rupture de tendance dans les séries piézométriques.
D’après les résultats obtenus, il existe une faible dépendance entre les séries de données piézométriques et hydroclimatiques. Les variables hydroclimatiques expliquent moins de 30% les fluctuations du niveau de la nappe. Il serait important de tenir compte de la topographie et du type d’aquifères dans les simulations. Un bon suivi des piézomètres est important pour
une bonne estimation du niveau de la nappe. Les séries de données piézométriques ont plusieurs périodes ayant une tendance à la hausse.
Abstract : This study aims to evaluate the dependence between the groundwater levels and hydroclimatic variables in southwestern Burkina Faso. In this country, much of the population depends on groundwater for its drinking water supply. The renewal of this resource is provided by a recharge of aquifer which depends for its share of precipitation, evapotranspiration and runoff... etc. It is established that an increase in air temperature leads to higher evaporation and infiltration of precipitation depends on the type of rainfall event (duration, intensity, frequency), which could lead to a reduction in recharge aquifers.
Time series of groundwater levels, precipitation, temperature, evapotranspiration, moisture minimum and maximum speed of wind and river flows have been used to study the relationship between climate and Water levels in aquifers. Available data for this study gathered information from 10 piezometers, 14 gauging stations and six meteorological stations in Burkina Faso. All the data extends over a length of 1-40. Multivariate statistics has been made in order to see the level of dependency in data sets, this level of dependence was later confirmed by statistical tests of Student and Mann Kendall. The model summary level aquifer was done through multiple linear regression, Finally, we used linear regression with time to determine trends in periods of break in the series piezometric.
According to the results obtained, there is a slight dependence between the series of piezometric data and hydroclimatic. Hydroclimatic variables explain less than 30% fluctuations in the level of the water. It is important to take into account the topography and type of aquifers in the simulations. Good monitoring piezometers is important for a good estimate of the level of the aquifer. The piezometric data sets have several periods with a rising trend.Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Analyse de la dépendance entre les variables piézométriques et hydroclimatiques du Sud-Ouest du Burkina Faso [texte imprimé] / Romain FOKA . - 2010 . - 79p.
Langues : Français (fre)
Résumé : Cette étude a pour but d’évaluer la dépendance entre les niveaux piézométriques et les variables hydroclimatiques du sud-ouest du Burkina Faso. Dans ce pays, une bonne partie de la population dépend de l’eau souterraine pour son approvisionnement en eau potable. Le renouvellement de cette ressource est assuré par une recharge des aquifères qui dépend pour sa part des précipitations, de l’évapotranspiration et du ruissellement.. etc. Il est établi qu’une hausse de la température de l’air induit une plus forte évaporation et que l’infiltration des précipitations dépend du type d’événement pluvieux (durée, intensité, fréquence), ce qui pourrait amener une réduction de la recharge des aquifères.
Des séries chronologiques de niveaux piézométriques, des précipitations, des températures, de l’évapotranspiration potentielle, de l’humidité minimale et maximale, de la vitesse du vent et de débits de rivière ont été utilisées pour étudier la relation existant entre les climats et les niveaux d’eau dans les nappes aquifères. Les données disponibles pour cette étude rassemblent les informations provenant de 10 piézomètres, 14 stations de jaugeages et 6 stations météorologiques situées au Burkina Faso. Toutes les données s’étendent sur une longueur de 1 à 40. La statistique multivariée a été faite dans le but de voir le niveau de dépendance dans les jeux de données, ce niveau de dépendance a été ensuite confirmé par les tests statistiques de Student et de Mann Kendall. La modélisation sommaire du niveau de la nappe a été faite grâce à la régression linéaire multiple, enfin nous avons utilisé la régression linéaire en fonction du temps pour déterminer la rupture de tendance dans les séries piézométriques.
D’après les résultats obtenus, il existe une faible dépendance entre les séries de données piézométriques et hydroclimatiques. Les variables hydroclimatiques expliquent moins de 30% les fluctuations du niveau de la nappe. Il serait important de tenir compte de la topographie et du type d’aquifères dans les simulations. Un bon suivi des piézomètres est important pour
une bonne estimation du niveau de la nappe. Les séries de données piézométriques ont plusieurs périodes ayant une tendance à la hausse.
Abstract : This study aims to evaluate the dependence between the groundwater levels and hydroclimatic variables in southwestern Burkina Faso. In this country, much of the population depends on groundwater for its drinking water supply. The renewal of this resource is provided by a recharge of aquifer which depends for its share of precipitation, evapotranspiration and runoff... etc. It is established that an increase in air temperature leads to higher evaporation and infiltration of precipitation depends on the type of rainfall event (duration, intensity, frequency), which could lead to a reduction in recharge aquifers.
Time series of groundwater levels, precipitation, temperature, evapotranspiration, moisture minimum and maximum speed of wind and river flows have been used to study the relationship between climate and Water levels in aquifers. Available data for this study gathered information from 10 piezometers, 14 gauging stations and six meteorological stations in Burkina Faso. All the data extends over a length of 1-40. Multivariate statistics has been made in order to see the level of dependency in data sets, this level of dependence was later confirmed by statistical tests of Student and Mann Kendall. The model summary level aquifer was done through multiple linear regression, Finally, we used linear regression with time to determine trends in periods of break in the series piezometric.
According to the results obtained, there is a slight dependence between the series of piezometric data and hydroclimatic. Hydroclimatic variables explain less than 30% fluctuations in the level of the water. It is important to take into account the topography and type of aquifers in the simulations. Good monitoring piezometers is important for a good estimate of the level of the aquifer. The piezometric data sets have several periods with a rising trend.Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques

Mémoire_FOKA RomainAdobe Acrobat PDFMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Analyse de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans la résolution Des problèmes environnementaux liés à la gestion de l’eau dans l’espace CEDEAO. / Kakou Arsène BATCHO

Titre de série : Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE Titre : Analyse de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans la résolution Des problèmes environnementaux liés à la gestion de l’eau dans l’espace CEDEAO. Type de document : texte imprimé Auteurs : Kakou Arsène BATCHO Année de publication : 2008 Importance : 34p. Langues : Français (fre) Résumé : L’eau douce est une ressource vitale à la vie. Elle est indispensable à la survie des écosystèmes naturels et à des activités humaines. Cette ressource fait l’objet d’une gestion à travers toutes les civilisations humaines. Les hommes, pour satisfaire leurs besoins vitaux ont recours à l’eau pour leurs différentes activités économiques. Cette situation a entraîné une utilisation concurrentielle et sectorielle de la ressource au point où certaines composantes ont pris le pas sur d’autres. Ainsi l’agriculture à elle seule consomme environ 70 % de la ressource en eau douce. Cette gestion sectorielle et concurrentielle de la ressource est à l’origine de nombreux problèmes tels que les conflits, la dégradation de la qualité de l’eau et les problèmes d’environnement. Face à ces multiples problèmes qui ne garantissent pas la durabilité de la ressource eau et de l’environnement, la communauté internationale a décidé de se pencher sur la question de la gestion des ressources eau. Ainsi une nouvelle approche de gestion a vu le jour: gestion intégrée des ressources en eau.
Cette nouvelle approche de gestion reste une solution pour la prise en compte des problèmes d’environnement et des problèmes liés à la gestion sectorielle de l’eau de façon générale. Loin d’être la solution idéale, la GIRE pourrait contribuer à la résolution d’énormes problèmes liés à la gestion sectorielle qui caractérise le secteur.
Dans le contexte ouest-africain, la gestion intégrée des ressources en eau est encore à ses débuts. Dans l’ensemble, plusieurs actions sont en cours afin de mettre en oeuvre la GIRE.
Mais ce qu’il a lieu de signaler est que malgré les multiples actions entreprises pour la mise en oeuvre de la GIRE, le volet environnement reste à la traine. En effet dans les différentes dispositions mise en place pour la mise en oeuvre de la GIRE l’environnement est souvent évoqué, mais dans la pratique on s’en rend compte que l’environnement reste encore le maillon faible de la GIRE dans l’espace CEDEAO.Mémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Analyse de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans la résolution Des problèmes environnementaux liés à la gestion de l’eau dans l’espace CEDEAO. [texte imprimé] / Kakou Arsène BATCHO . - 2008 . - 34p.
Langues : Français (fre)
Résumé : L’eau douce est une ressource vitale à la vie. Elle est indispensable à la survie des écosystèmes naturels et à des activités humaines. Cette ressource fait l’objet d’une gestion à travers toutes les civilisations humaines. Les hommes, pour satisfaire leurs besoins vitaux ont recours à l’eau pour leurs différentes activités économiques. Cette situation a entraîné une utilisation concurrentielle et sectorielle de la ressource au point où certaines composantes ont pris le pas sur d’autres. Ainsi l’agriculture à elle seule consomme environ 70 % de la ressource en eau douce. Cette gestion sectorielle et concurrentielle de la ressource est à l’origine de nombreux problèmes tels que les conflits, la dégradation de la qualité de l’eau et les problèmes d’environnement. Face à ces multiples problèmes qui ne garantissent pas la durabilité de la ressource eau et de l’environnement, la communauté internationale a décidé de se pencher sur la question de la gestion des ressources eau. Ainsi une nouvelle approche de gestion a vu le jour: gestion intégrée des ressources en eau.
Cette nouvelle approche de gestion reste une solution pour la prise en compte des problèmes d’environnement et des problèmes liés à la gestion sectorielle de l’eau de façon générale. Loin d’être la solution idéale, la GIRE pourrait contribuer à la résolution d’énormes problèmes liés à la gestion sectorielle qui caractérise le secteur.
Dans le contexte ouest-africain, la gestion intégrée des ressources en eau est encore à ses débuts. Dans l’ensemble, plusieurs actions sont en cours afin de mettre en oeuvre la GIRE.
Mais ce qu’il a lieu de signaler est que malgré les multiples actions entreprises pour la mise en oeuvre de la GIRE, le volet environnement reste à la traine. En effet dans les différentes dispositions mise en place pour la mise en oeuvre de la GIRE l’environnement est souvent évoqué, mais dans la pratique on s’en rend compte que l’environnement reste encore le maillon faible de la GIRE dans l’espace CEDEAO.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BATCHO Kakou arsène//0812 M. 0812 Monographie Bibliothèque CDI-Ouaga Documents Disponible Documents numériques

BATCHOAdobe Acrobat PDFMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Analyse des impacts des changements climatiques sur la ressource en eau du barrage de Kompienga (Burkina Faso) à l’horizon 2025 / Tôg-Noma Patricia Emma BONTOGHO

PermalinkMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Analyse des impacts des changements climatiques sur la ressource en eau du barrage de Kompienga (Burkina Faso) à l’horizon 2025 / Tongnoma Alice BONKOUNGOU

PermalinkMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Analyse des impacts des changements climatiques sur la ressource en eau du barrage de Kompienga (Burkina Faso) à l’horizon 2025 / Manounata KABORE

PermalinkMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Calcul de la productivité de l’eau dans les zones de production de l’office du Niger au Mali / Moussa DIAKITE

PermalinkMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Caractérisation hydrologique des sous-bassins de la Sandougou en vue de la définition d’espaces de gestion et de valorisation des ressources en eau au profit des communautés. / Sompohi Guy Pacôme ZADE

PermalinkMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Cohérence des politiques de développement sectorielles en Afrique de l’ouest et place des outils d’aide à la décision / Amélie TRAORE / HIEN

PermalinkMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Compatibilites des pratiques agro-sylvo-pastorales et mise en œuvre de la gire dans l’espace de gestion du nakanbe. / Rokiatou CARABIRI

PermalinkMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Contribution des barrages à la gestion des ressources en eau et impacts sur l’environnement et la santé en Afrique de l’Ouest et du Centre / Anselme Crépin MAMA

PermalinkMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Contribution à l’élaboration d’un plan de développement de l’adduction d’eau potable(AEP) dans la zone d’intervention de GWI Niger / Bachir YACOUBA MAHAMAN

PermalinkMémoire FPL Master Spécialisé GIRE. Contribution à l’étude de la qualité des eaux du bassin du Congo / Heri SAFARI

Permalink